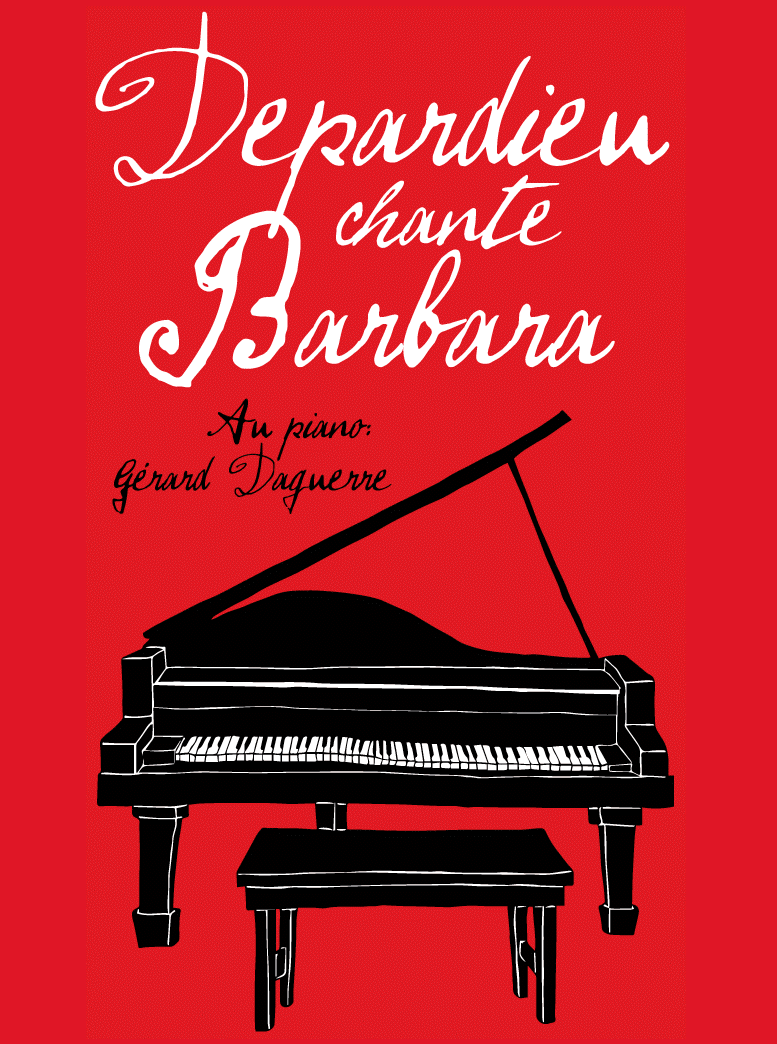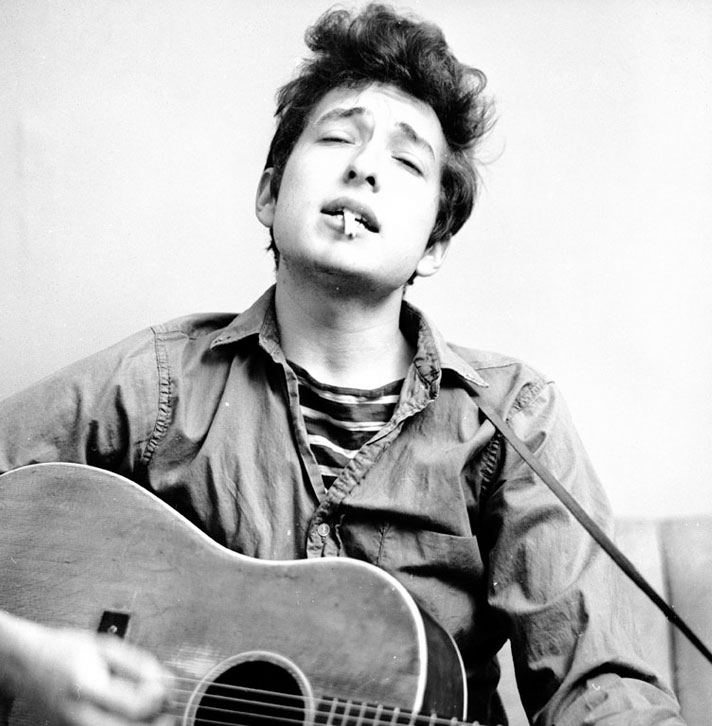Dernier long métrage de Bergman, conçu en quatre épisodes pour la télévision avant un format pour les salles, Fanny et Alexander avait été adapté pour la scène par Julie Deliquet, en 2019 pour la Comédie Française. Avec la production d’Ivo van Hove, metteur en scène nourri par le patrimoine cinématographique, à l’exemple des Damnés d’après Visconti, l’ouvrage devient un opéra, sur un livret de Royce Vavrek et une partition de Mikael Karlsson – suédois comme le célèbre cinéaste. Dans la scénographie de Jan Versweyveld, le destin de la famille Ekdahl, depuis la mort d’Oscar lors d’une répétition d’Hamlet jusqu’à celle de l’évêque sous l’emprise duquel vivait la veuve, est raconté sous un mode immersif, en associant les références théâtrales du récit et sa construction qui en font une forme d’opéra-film. Les projections vidéos de Christopher Ash donnent un supplément de mobilité quasi réaliste au décor, mais assument également le glissement vers le fantastique lors de l’apparition des fantômes des deux fillettes ou encore au moment de la rencontre aux allures mystiques avec Ismaël, avant l’incendie où périra l’homme d’église à l’autoritarisme intransigeant.
La partition de Mikael Karlsson privilégie une fluidité entre le chant et la déclamation chantée, favorable à une intelligence évidente du texte. La pâte orchestrale affirme une certaine maîtrise des couleurs et des textures, dans une homogénéité sonore calibrée avec une belle efficacité par Ariane Matiakh, et renforcée par le lissage acoustique permettant un équilibre entre les différents registres vocaux.
Un témoin de l’évolution du genre lyrique
Le choix d’un tel dispositif de confort dans la diffusion de la matière musicale s’inscrit dans une tendance générale à l’extension de son usage au-delà des répertoires habituels – jazz, pop, rock et autres, où on l’emploie d’abord à des fins d’amplification. Face au paradigme cinématographique et son écran haute-fidélité, les irréguralités naturelles de l’environnement du théâtre musical risquent de devenir bientôt archéologiques.
L’apparition de certaines icônes des scènes d’opéra de ces dernières décennies, désormais en fin de carrière, dans des emplois travaillés comme ceux d’un musical, l’illustre de manière éloquente – la nomenclature mentionne d’ailleurs, comme pour Broadway les noms des librettiste et compositeur à égalité. Thomas Hampson condense la raideur autoritaire, sectaire, de l’évêque Vergerus, secondé par la ruse perverse de sa gouvernante Justina, campée avec une saisissante vérité psychologique par Anne Sofie von Otter. Sous la regard bienveillante de la matriarche Helena Ekdahl, incarnée par Susan Bullock, Sasha Cooke résume la détresse d’Helena, après la disparition d’Oscar – Peter Tantsits s’y révèle d’une présence remarquable. Membres du choeur d’enfants de La Monnaie, Lucie Penninck et Jay Weiner font valeur la fraîcheur contrastée de Fanny et Alexandre, le jeune garçon étant davantage mis en avant par le drame. Les autres interventions de la tribu Ekdahl ne sont pas moins pertinentes, avec Loa Falkman en Isak Jacobi, Alexander Sprague en Aron et l’Ismaël d’Aryeh Nussbaum Cohen. Les deux autres couples de la fratrie – Carl et Lydia, Gustav Adolf et Alma – sont dévolus sans démérite, respectivement à Justin Hopkins et Polly Leech, Gavan Ring et Margaux de Valensart. Ce spectacle qui se suit – et s’écoute – avec plaisir et intérêt, porte l’empreinte d’une évolution d’une partie de la création lyrique contemporaine qui ne manque pas de laisser affleurer des questions quant à l’avenir du genre opéra.
Par Gilles Charlassier
Fanny et Alexandre, Théâtre de La Monnaie, décembre 2024