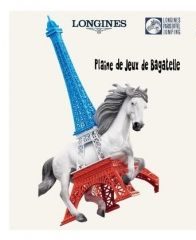La Belgique met le Donizetti français à la mode en cette fin d’automne. Tandis que Liège met à l’affiche une nouvelle Favorite coproduite avec la Fenice de Venise, Gand reprend une recréation du Duc d’Albe présentée pour la première fois à l’Opéra des Flandres en 2012. La partition ne réservant pas de rôle de premier plan à Rosine Stolz, la maîtresse du directeur de l’Opéra de Paris d’alors, Léon Pillet, elle sera abandonnée par Donizetti avant de pouvoir être jouée, et restera plusieurs décennies dans les bibliothèques avant d’être donnée en italien, à Rome, en 1882, complétée par Matteo Salvi. Soixante-quinze plus tard, le chef Thomas Schippers en dirigera une version révisée par ses soins, mais il faudra attendre le début du vingt-et-unième siècle pour découvrir enfin l’original français. Avec une action qui fait partie de l’histoire hispanique et flamande, les massacres du Duc d’Albe et la révolte du peuple sous le règne de Philippe II d’Espagne, l’institution lyrique gantoise semblait prédestinée à accueillir cette redécouverte – ce que le directeur Aviel Cahn a intelligemment compris, qui a d’ailleurs convié à l’un des représentations l’ambassadeur d’Espagne et Puigdemont : seul ce dernier a répondu à l’invitation.
Et pour cette redécouverte, il a fait appel à un des grands noms de l’opéra d’aujourd’hui, Giorgio Battistelli, pour pallier les quelques lacunes laissées par Donizetti dans les deux derniers actes. Si au troisième, celui-là se limite à quelques récitatifs aux dissonances savamment dosées et aux confins de la déclamation, les dernières pages du quatrième seront entièrement de sa main. Dans la mort de Henri de Bruges, le chant s’évanouit progressivement vers d’ultimes paroles d’adieu, en même temps que la manière de Donizetti fait place à celle de Battistelli, avec une subtile délicatesse qui compte parmi les grands moments de la soirée, au point que le choeur final semble presque redondant, sinon étranger.
Une scénographie habile
A la tête de l’Orchestre de l’Opéra des Flandres, Andriy Yurkevych ne cherche pas à masquer l’apparente hétérogénéité de la partition, et n’accentue pas inutilement les effets verdiens ou grand opéra à la française que l’on reconnaît ça et là, mettant en valeur les passages les plus inspirés – le début du finale du deuxième acte, avec son vaste choeur très architecturé, qui fait regretter une suite plus commune, ou encore les duos entre père et fils, le duc et Henri.
Avec un texte en français, on pourrait s’attendre à faire abstraction de surtitres proposés seulement en néerlandais – à l’inverse de Liège qui, aux côtés du français, affiche allemand et flamand. En Duc d’Albe, Kartal Karagedik, qui a dû apprendre le rôle en deux semaines à la suite de la défection pour maladie du soliste prévu, s’avère le plus compréhensible. Le jeune et solide baryton turc souligne les contradictions du personnage, agrémentées de tics de consanguinité non nécessaires demandés par la direction d’acteur. Soutenu par un mécène brugeois, Enea Scala bonifie son Henri de Bruges au fil de la soirée, un peu prudent au début avant de parvenir à un équilibre entre éclat et musicalité, jusque dans un trépas d’une admirable sensibilité. Ania Jeruc détaille la vaillance implacable d’Hélène d’Egmont, quand David Shipley ne ménage pas la brutalité de Sandoval. Le brasseur Daniel revient à la basse Markus Suihkonen, honnête. Les choeurs sont efficacement préparés par Jan Schweiger.
Quant à la mise en scène, réglée par Carlos Wagner, elle s’appuie sur les décors très picturaux d’Alfons Flores, rehaussés par Fabrice Kebour. Après une ouverture dominée par l’éclatement de l’effigie de la madone protectrice, des statues géantes de soldats avec mitraillettes évoquent la Grande Guerre, à peine contredite au quatrième acte par une nuée d’avions plus proche de la Libération, annonçant la fin du tyran. Ce sont indéniablement les qualités plastiques de la scénographie que l’on retiendra, utilisant avec habileté les ressources du plateau, jusqu’à la passerelle montant vers les cintres alors que s’exile le Duc d’Albe, tandis que le choeur final est entonné par une foule de silhouettes décapitées, entre clin d’oeil surréaliste et stigmates de combats sanglants. En somme, un accompagnement visuel et poétique parfois inégal, au service d’une redécouverte salutaire.
Par Gilles Charlassier
Le Duc d’Albe, Gand, jusqu’au 6 décembre 2017












 [/popup]
[/popup]