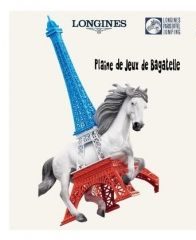Paris n’étant heureusement pas le seul centre du monde lyrique – surtout avec l’assoupissement du vaisseau Bastille depuis quelque temps – votre fidèle Melomaner est allé respirer l’air de quelques autres maisons d’opéra pendant cette fin d’hiver.
Et la première étape est berlinoise, à la Staatsoper, qui a investi le Schiller Theater, le temps des travaux dans le bâtiment historique de l’Unter den Linden, et qui a fait venir fin janvier une Katia Kabanova venue de Bruxelles où la Monnaie l’avait présentée en 2010. La mise en scène d’Andrea Breth prend délibérément le parti de la noirceur, voire du glauque. La réunion de famille au deuxième acte se tient devant un glacial rideau de pluie, tandis que l’héroïne de Janacek meurt en s’ouvrant les veines au-dessus de la baignoire avant d’y plonger – à défaut de la Volga indiquée dans le livret –, victime de l’oppression morale de Kabanicha, sa belle-mère, remarquablement caractérisée par une Deborah Polaski qui fait oublier sa fatigue vocale. Dans le rôle-titre, on retrouve l’incandescente Eva-Maria Westbroek, composition que la soprano néerlandaise se devait d’ajouter à son répertoire. On retiendra aussi le Boris de Pavel Cernoch et l’insouciante Varvara charnue d’Anna Lapkovskaja. Quant à la direction de Simon Rattle, elle surprend par son souci d’adoucir l’expressivité si particulière de l’écriture de Janacek au profit d’une sonorité lumineuse et claire quoique nourrie, regardant parfois plus vers Debussy que vers la Moravie.
Le baroque revisité
Sur sa scène secondaire, le Werkstatt, la Staatsoper présentait en même temps Lezioni di tenebra, « réduction » contemporaine en format musique de chambre du Giasone de Cavalli, élève de Monteverdi, due à Lucia Ronchetti, créée en 2011 à la Konzerthaus de Berlin et mis en scène ici par Reyna Bruns. La réécriture moderne d’ouvrages baroques connaît ces dernières années un regain d’intérêt – à l’instar d’Helmut Oehring revisitant The Fairy Queen de Purcell, ou encore son Orfeo 14 d’après Monteverdi programmé en juin prochain à Lille. Loin de trahir l’original, cette condensation en démultiplie les rythmes et les couleurs grâce à un habile dosage des percussions et de l’informatique musicale. A la façon de Brecht, la scénographie économe en matériaux rend visible les entrées successives des personnages, renforçant la lisibilité d’une histoire qui remanie un peu le mythe originel. Si les six jeunes solistes progresseront sans doute encore au fil des prochaines années, ils s’investissent admirablement dans ce jeu d’illusions et d’échos, parfait exemple de théâtre pauvre, mais riche d’imagination autant que d’intelligence. Une preuve que la magie théâtrale n’est pas qu’une question de moyens et que l’on aimerait volontiers emmener à Paris.
Stuttgart à l’heure israélienne
C’est un tout autre budget qui avait été alloué à Mark Andre, compositeur franco-allemand, pour son premier opéra Wunderzaichen tout juste créé à l’Opéra de Stuttgart, et qui lui a demandé sept ans de travail, utilisant comme base les « photographies acoustiques » prises dans différents lieux de Jérusalem pendant un voyage avec le librettiste Patrick Hahn . L’histoire se déroule à l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv : l’humaniste Johannes Reuchlin, projeté dans notre monde contemporain, se fait refouler par un douanier à l’entrée d’Israël, alors qu’il veut entrer dans un pays dont la langue et la religion ont occupé sa vie entière. Il mourra à l’aéroport et ne pourra qu’observer ce qui s’y passe hors de son corps. Pendant deux heures, l’œuvre se situe perpétuellement à la frontière du bruit et de la musique : sur un tissu de borborygmes instrumentaux, de frottements d’archets, de chuchotements, le personnage principal, tenu par l’acteur André Jung, parle et pense. Aux confins de la narration et de la vocalité où Ligeti s’était tenu pendant une dizaine de minutes dans Atmosphères, Mark Andre juxtapose texte et éléments sonores en une sorte de suspension infinie. Cette avant-garde éventée et dispendieuse en technologie – réalisée par l’Experimentalstudio du SWR – s’inscrit dans une scénographie d’Anna Viebrock traduisant l’impersonnalité de ces lieux de transit que sont les aérogares. L’enthousiasme convaincu des interprètes et du chef d’orchestre Sylvain Cambreling ne s’est cependant pas révélé nécessairement contagieux.
Festin vocal
Changement de décor avec La Gioconda de Ponchielli présentée à la Deutsche Oper de Berlin dans une mise en scène quadragénaire : Venise de carton-pâte et direction d’acteurs minimale garantis, dont le kitsch suscite quelques applaudissements à chaque lever de rideau, et bien évidemment après la fameuse Danse des Heures à la postérité de laquelle Fantasia a largement contribué. Mais c’est surtout le plateau vocal que l’on retiendra de cette énième reprise, avec Marcelo Alvarez, Enzo en grande forme, une solide Hui He dans le rôle-titre, et le sombre Barbaba confié à Lado Ataneli, l’ensemble étant placé sous la baguette de Jesus Lopez Cobos.
Festin de jolis gosiers et de bel canto également à Barcelone avec La Somnambula dans la belle production de Marco Arturo Marelli étrennée à Vienne et vue à Paris avec Natalie Dessay il y a deux ans. L’élégant sanatorium helvétique baigné de neige et d’une poétique lumière lunaire à l’heure du somnambulisme signale les instincts de décorateurs du metteur en scène zurichois. On y voit évoluer l’Amina de Patrizia Ciofi, douée d’un infaillible instinct théâtral, aux côtés d’un Juan Diego Florez à l’aura vocale toujours intacte. Nicola Ulivieri assume un Rodolfo de belle étoffe, même si on peut lui préférer le lendemain le naturel et l’évidence d’un Michele Pertusi. Annick Massis s’y distingue par sa musicalité aux côtés de l’estimable Elvino campé par Celso Albelo. Des deux Lisa, on préférera celle d’Eleonora Buratto, plus fouillée que celle de Sabina Puertolas. Mentionnons encore Teresa, la mère, remarquablement jouée par Gemma Coma-Alabert, et bien entendu la direction vibrante de Daniel Oren. Un beau spectacle que l’on ne se lasse pas de revoir tant l’oreille est comblée.
De Toulouse à Moscou
Les tournées ne sont pas l’apanage du Melomaner : l’Orchestre du Capitole de Toulouse emmène dans ses bagages le souffle puissant de Boris Godounov, sous la baguette de Tugan Sokhiev qui à trente-six ans vient d’être nommé au Bolchoi. Des deux versions que Moussorgski a réalisées, le chef ossète a retenu la première, plus condensée – sans l’acte polonais entre autres – qui se referme sur la mort du tsar, sans le retour de l’Innocent et sa plainte sur le fatal et triste destin de l’éternelle Russie. Deux heures sans entracte portées par le souffle puissant du drame de Pouchkine et emmenées par une distribution presqu’entièrement slave, à l’exception du rôle-titre, littéralement habité par Ferruccio Furlanetto, même si d’aucuns préfèreraient d’autres idiosyncrasies. On notera le solide Pimène d’Ain Anger, la Xénia d’Anastasia Kalagina, le pittoresque Varlaam d’Alexander Teliga ou le Fiodor rondouillet de Svetlana Lifar, sans oublier le chœur Orfeon Donostiarra, largement sollicité dans les tableaux de cette formidable fresque dont les russes ont le secret.
Berlin-Paris
Terminons notre panorama de l’hiver musical avec le festival Présences, rendez-vous annuel de la création contemporaine soutenu par Radio France et placé sous le signe de Paris-Berlin. Souffrant sans doute d’une répartition des lieux et d’une politique tarifaire en manque de cohérence – l’édition consacrée à Salonen il y a trois ans, encore marquée du sceau de la gratuité avait rencontré un très vif succès, du en partie sans doute à la célébrité du chef d’orchestre finlandais – le concert d’ouverture peine à remplir le Théâtre du Châtelet. C’est dommage, car si les Hérédo-Ribotes de Fabien Lévy essaient de faire passer pour de l’inspiration des procédés largement éprouvés, l’Elégie de Jörg Widmann, concerto que le compositeur joue lui-même à la clarinette avec l’Orchestre national de France témoigne d’une intelligente virtuosité et d’un authentique sens poétique qui ne peut que rendre service à un répertoire contemporain trop souvent jugé abscons et intellectualiste. On ne pourra en faire le reproche à la pièce un peu facile d’Oliver Schneller, WuXing/Water, tandis que le Sebastian im Traum de Henze refermant la soirée fournit une fois de plus la preuve du génie du musicien allemand disparu il y a deux ans.
Par Gilles Charlassier
Katia Kabanova et Lezioni di tenebra, Staatsoper Berlin, janvier-février 2014 ; La Gioconda, Deutsche Oper Berlin, janvier-février 2014 ; La Somnambula, Liceu Barcelone, janvier-février 2014 ; Boris Godounov, salle Pleyel Paris, février 2014 ; Festival Présences Paris, février 2014 ; Wunderzaichen, Opera Stuttgart, mars 2014.











 [/popup]
[/popup]