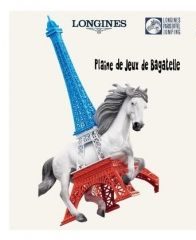Au risque de se répéter, force est de souligner combien Paris est loin d’avoir le monopole de l’originalité dans la programmation lyrique, et cette saison plus que jamais peut-être. Présentée à Marseille il y a quelques années, la production de L’Aiglon réglée par Renée Auphan, d’après la conception de Patrice Caurier et Moshe Leiser, constitue, sans nul doute, pour l’Opéra de Lausanne, une remarquable manière de refermer sa première saison dans ses murs historiques, rénovés après cinq ans de fermeture pour travaux et dotés désormais d’outils techniques à la mesure de ses ambitions.
A quatre mains
Rarement représenté depuis sa création à l’Opéra de Monte-Carlo en 1937, L’Aiglon présente par ailleurs cette particularité d’être le fruit d’une collaboration à quatre mains entre Jacques Ibert et Arthur Honegger – au Français incomba le premier et dernier acte ainsi que les valses du troisième tandis que la matière plus dramatique naquit sous la plume du compositeur suisse, laquelle atteint un climax dans la confrontation avec Metternich qui referme le deuxième acte. Inspiré par la pièce éponyme d’Edmond Rostand, l’ouvrage retrace le destin du fils de Napoléon Ier, le Duc de Reichstadt, surnommé l’Aiglon, exilé à Vienne après la défaite de l’Empire et dont les fragiles ailes ont été soigneusement brisées par Metternich. De manière symptomatique, les titres successifs des cinq actes déclinent cette trajectoire, des « Ailes qui s’ouvrent » aux « Ailes fermées », en passant par les « Ailes qui battent », les « Ailes meurtries » et les « Ailes brisées ».
On retrouve dans le livret d’Henri Caïn une part de la grandiloquence de la pièce originelle, entre autres dans la tirade de Flambeau, incarné avec une admirable justesse de style par Marc Barrard. En comparaison, le Metternich de Franco Pomponi sonne plus teuton que nature, sacrifiant à la crédibilité historique. Mais c’est sans nul doute l’incandescence de Carine Séchaye dans le rôle-titre qui retient l’attention et l’émotion – on lui pardonnera une fragilité vocale qui, en fin de compte, sert la caractérisation du personnage. Une belle incarnation par cette mezzo à peine trentenaire qui se produit régulièrement sur la scène de Lausanne : à bon droit, la fidélité récolte ses fruits. Au sein de la cour qui gravite autour de l’héritier déchu se distinguent la Thérèse de Lorget campée avec grâce et fraîcheur par Carole Meyer ; l’altière Marie-Louise, duchesse de Parme, que revêt Marie Karall ; ou encore l’attaché militaire français qui incombe à Christophe Berry.
Le sens du style
Grand connaisseur de ce répertoire, et par ailleurs doué d’un instinct infaillible, Jean-Yves Ossonce révèle avec autant de finesse que d’efficacité les atmosphères contrastées de la partition, de la légèreté mondaine à la sombre introspection. Servie avec autant d’amour, une telle œuvre ne peut que mériter la sortie de l’oubli. D’autant que la mise en scène sobre, parfois un rien décorative dans le souci de l’apparat, grave de magnifiques tableaux à l’unisson de la musique, à l’instar de la mémorable séquence du miroir qui referme le deuxième acte. Si l’on ajoute un estimable travail sur l’intelligibilité de la langue, tant de la part des solistes que des chœurs, il ne reste plus d’obstacle pour l’envol de cet Aiglon, lequel se posera d’ailleurs à l’Opéra de Tours au milieu du mois de mai – avec les mêmes protagonistes.
GC
L’Aiglon, Opéra de Lausanne, 28 avril 2013 ; à Tours, du 17 au 21 mai 2013











 [/popup]
[/popup]