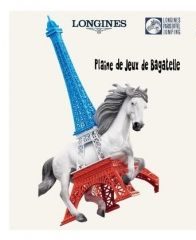On savait les origines saxonnes de Haendel – né à Halle, près de Leipzig en 1685 – mais entendre un opéra italien traduit en allemand ne peut manquer de surprendre, a fortiori un spectateur non germanique. C’est pourtant le choix de Stefan Herheim dans son Xerxes importé de la Deutsche Oper de Berlin sur la scène de Düsseldorf. Seuls ont été préservés quelques airs et ensembles, comme le célèbre « Ombrai mai fu » qui ouvre le premier acte et connu comme le « Largo » de Xerxes, ou encore le chœur final avant qu’il ne soit repris dans la langue vernaculaire du public, sorte de mise à distance de l’illusion théâtrale. Ce défi aux puristes reprend pourtant la pratique très à la mode au dix-huitième siècle de l’opéra cosmopolite – Orpheus de Telemann est ainsi chanté, au gré des styles, en français, allemand et italien – même si la présente réécriture répond sans doute davantage à des exigences dramaturgiques que musicales.
Haendel déjanté en version allemande
Cela s’avère d’autant plus évident que l’inventif metteur en scène norvégien ne se montre pas avare en astuces et clins d’œil pour animer le galimatias un tantinet hystérique de rivalités amoureuses caractérisant le répertoire lyrique italien du settecento. Certes, costumes et décors font allégeance à l’imaginaire d’époque. Mais Stefan Herheim fait preuve d’une réjouissante habileté à jouer de trompe-l’œil et d’impertinence, à l’instar de cette aria où le roi de Perse intervertit les consonnes de son nom – « rex-sex » : on ne surprend personne, le pouvoir et les hormones restent de tout temps les mamelles nourricières de l’humanité.
Le public en redemande, d’autant que le plateau vocal se met au diapason jubilatoire de ce spectacle en manchettes déjanté. Confié à Berlin à une mezzo, le rôle-titre incombe ici au jeune contreténor roumain Valer Barna-Sabadus dont les vocalises et l’extravagance ne portent guère les stigmates d’un rhume annoncé au début de la soirée – seul son jeu d’acteur pourrait parfois inciter à l’indulgence. En Arsamenes, le frère rival, Terry Wey ne manque pas de panache, bien que moins exposé. Quant à la direction de Konrad Junghänel, aussi généreuse que la sonorité des Neue Düsseldorfer Hofmusik, elle démontre opportunément que la musique baroque ne se confond pas nécessairement avec quelque végétarisme orchestral.
Vienne à Cologne
Sise aux pieds de la majestueuse cathédrale, la Philharmonie de Cologne s’élève comme sous le patronage de Robert Schumann – dont le finale de la Troisième Symphonie dite « Rhénane » assure la fonction d’avertir le public du début du concert, cela vaut bien le glas de la Bastille… Le hasard du calendrier a voulu pourtant que l’on y entende le Philharmonique de Vienne emmené par l’un de ses plus fidèles serviteurs, le directeur musical de l’Opéra national de Vienne, Franz Welser-Möst, dans un prestigieux programme « autrichien », associant le Concerto pour violon de Berg à la Quatrième Symphonie de Bruckner.
Dédié « à la mémoire d’un ange », Manon Gropius, la fille d’Alma Mahler, le concerto de Berg traite le grand orchestre avec une transparence chambriste héritée de Mahler, sur laquelle le soliste tisse son chant presque ininterrompu, à rebours du traditionnel affrontement dont s’est montré friand le romantisme. Fragile et concentré, l’archet de Frank-Peter Zimmermann livre une leçon de musicalité, mais l’émotion reste prisonnière de ce vernis de perfection. La symphonie de Bruckner, surnommée « Romantique », va apporter, après l’entracte, la réponse. Plus à l’aise avec les masses sonores, Franz-Welser Möst sculpte le granit brucknérien qu’il fait vibrer de manière que l’on ose qualifier d’épique. Sans éluder une intériorité mystique, en particulier dans le choral du mouvement lent, c’est bien une fresque musicale que nous fait entendre le Philharmonique de Vienne, puissante et compacte – l’inverse pour ainsi dire de Berg. Un authentique travail de symphoniste qui témoigne, une fois de plus, de l’excellence du chef autrichien, baigné de tradition.
Berlioz à Darmstadt
Quittant le Rhin pour le Main, c’est à Darmstadt que s’achève notre croisière germanique, avec un chef-d’œuvre négligé par la France, mais régulièrement à l’affiche des théâtres allemands : Les Troyens de Berlioz. Nul n’étant prophète en son pays, c’est d’ailleurs en Allemagne, à Karlsruhe – qui a depuis octobre 2011 à son répertoire une production de David Hermann – que fut donné pour la première fois l’ouvrage en son entier, en 1890, soit vingt ans après la mort du compositeur. Ici on retrouve aux commandes le directeur de la maison, John Dew, dans une mise en scène au visuel très traditionnel. Si la première partie, « La Chute de Troie », souffre du statisme d’un décor de ruines fumantes, la seconde, « Les Troyens à Carthage », offre de beaux tableaux et des éclairages poétiques, en particulier le merveilleux duo nocturne du quatrième acte.
Le contraste se retrouve dans les voix, avec une Cassandre à la voix instable et à la diction problématique (Katrin Gerstenberger), alors qu’Erica Brookyser s’avère prometteuse dans sa prise de rôle en Didon. Le cas d’Enée laisse plus dubitatif : Hugh Kash Smith affiche l’endurance nécessaire et s’efforce de respecter le style français, mais il faut composer avec un timbre ingrat et un aplomb d’acteur frisant le ridicule. On se console en songeant que, pour une fois, la partition n’a pas subi de coupures, servie par ailleurs fort honnêtement par Martin Lukas Meister et les forces du Théâtre national de Darmstadt. Ce qui n’échappe pas à l‘enthousiasme du public – preuve que Berlioz ne mérite pas le purgatoire qu’il continue de subir en son pays natal.
Par Gilles Charlassier
Xerxes, Düsseldorf, février 2013
Concert du Philharmonique de Vienne, Cologne, 21 février 2013
Les Troyens, Darmstadt, mars-avril 2013











 [/popup]
[/popup]