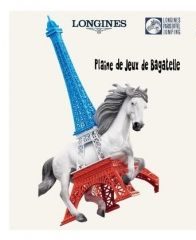A vrai dire la fête ne s’arrête jamais vraiment à Vienne, mais en pleine saison des bals, tradition inébranlable, la capitale des Habsbourg gâte particulièrement le mélomane, avec trois soirées. La première, au Staatsoper (l’Opéra national de Vienne), sanctuaire du crépusculaire des voix comme les affectionne tant le public viennois, a réservé un bel accueil à Grace Bumbry, soixante-seize printemps depuis le début de l’année et première Vénus noire (Tannhäuser) sur la Colline Verte en 1960, pour son ultime apparition dans La Dame de Pique de Tchaïkovski. Elle revêt ici les apprêts de la comtesse, dame d’un autre âge qui se souvient de sa jeunesse au temps des Pompadour et autres courtisanes. On la voit descendre les escaliers appuyée sur une canne – béquille du personnage ou de l’interprète, l’on ne saurait trancher, avec cette idée que c’est le propre des grands artistes que de confondre leur faiblesse avec celle de leur rôle… Autre grand emblème de la maison, Neil Schicoff, qui incarna un Eleazar d’anthologie dont il garda longtemps la jalouse exclusivité, réserve un valeureux Hermann. Mais le timbre ne peut masquer une certaine usure qui n’altère en rien un engagement théâtral absolu – voire excessif.
Décor Unique
Pour autant, la relève n’est pas oubliée, et l’on peut applaudir en Alisa Kolosova, ancienne pensionnaire de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris et lauréate du prix de l’AROP, une admirable Pauline, faisant ainsi de prometteurs débuts sur la première scène autrichienne. On retiendra également le Tomski généreux de Tómas Tómasson ainsi que la baguette attentive de Marko Letonja, le nouveau directeur musical du Philharmonique de Strasbourg entendu à l’automne en Alsace dans Le Son lointain de Schreker. Efficace dans son décor unique dessiné par Johannes Leiacker, la mise en scène de Vera Nemirova sert toutefois un propos essentiellement décoratif et n’exprime pas toute la noire puissance d’un chef d’œuvre trop rarement donné, payant sans doute une âpreté que le plus avenant Eugene Oneguine sait mieux enrober.
Le baroque dans l’aquarium
Saut d’un siècle et demi en arrière au Theater an der Wien avec Radamisto de Haendel. D’une inspiration mélodique intarissable au fil de la quarantaine d’opéras qu’il nous a légués, le Caro Sassone bénéficie d’un regain d’intérêt bienvenu qui nous fait redécouvrir des trésors que ne tempèrent guère les intrigues amoureuses emberlificotées prétextes à des airs sublimes et virtuoses. Ecrit au début de ses succès londoniens, Radamisto regorge de pages extraordinaires et habitées, en particulier au deuxième acte comme l’air du rôle-titre, «Ombra cara ». Et comment n’y pas succomber quand cette musique est servie par les meilleurs interprètes à l’instar de David Daniels, Sophie Karthaüser, Patricia Bardon ou Jeremy Owenden, habitués des roucoulades baroqueuses. Sans oublier la direction inventive de René Jacobs, musicologue chevronné doué d’une exquise sensibilité. Evitant les pièges du trop plein et du vide, Vincent Boussard se contente de laisser l’histoire couler sur un mur de projections urbaines peuplées de poissons verts. Incongru au premier abord, le procédé forme une tapisserie visuelle qui donne une appréciable cohérence au spectacle.
Fougue rossinienne
Pour finir, c’est Le Comte Ory de Rossini qui vient nous régaler en ce même lieu, les oreilles et les zygomatiques. Jugez plutôt: un jeune noble amateur de chair féminine se cache sous une soutane avant de soudoyer ses compagnons pour investir nuitamment le château de la comtesse Adèle dont il s’est épris. Mais le retour de l’époux légitime signera, dans une certaine précipitation, la retraite des audacieux démasqués. Annoncée souffrante, Cecilia Bartoli a laissé le rôle de la comtesse Adèle à sa cadette Pretty Yende. La soprano sud-africaine témoigne de son irrésistible fraîcheur dont on suivra avec intérêt la maturation. Petit et rondouillet, Lawrence Brownlee n’a pas le glamour de son rival Juan Diego Florez. Pourtant le ténor américain est l’une des valeurs établies du chant rossinien, et fait entendre une vocalité plus raffinée sinon plus idoine. On pourrait chicaner avec un français qui ne semble pas être son idiome naturel, qu’il apprivoise cependant avec habileté au fil de la soirée. L’éclat de cette voix solaire et le naturel de l’acteur font le reste. Pas étonnant que les plus grandes maisons se l’arrachent. On ne manquera pas l’impeccable Isolier de Regina Mühlemann, touchant de juvénile gaucherie, compensant celle plus regrettable de Pietro Spagnoli, Raimbaud. Tout ce petit monde est emmené avec fougue par un Jean-Christophe Spinosi peu avare d’agitation au milieu de la mise en scène parfaitement réglée de Moshe Leiser et Patrice Caurier. Le bonheur est parfois aussi simple que cela – pourquoi alors s’en priver ?
Par Gilles Charlassier
La Dame de Pique, Opéra national de Vienne, janvier 2013
Radamisto, Theater an der Wien, janvier 2013
Le Comte Ory, Theater an der Wien, février 2013












 [/popup]
[/popup]