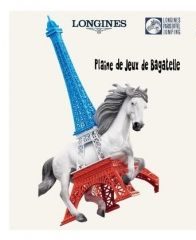Chaque soir, près de Paris, une famille ordinaire se déchire, plaçant ainsi un miroir devant un public conquis. Après Catégorie 3.1, Kliniken et Détails, Jean-Louis Martinelli, le directeur du théâtre Nanterre-Amandiers, poursuit son adaptation de l’œuvre de Lars Norén. Cette fois, c’est à travers l’autobiographie que le dramaturge suédois a exploré la complexité des relations entre parents et enfants, trouvant ainsi le moyen de démêler ses propres conflits intérieurs tout en racontant une histoire universelle. Écrite en 1984, Calme est une pièce sans âge qui trouvera toujours une résonance dans le présent de ses mises en scène. Elle se situe dans un hôtel-restaurant tenu par Ernst, le père, autour duquel tout s’écroule peu à peu, ravivant son penchant pour les allers-retours à la cave.
Un homme faible
Un rôle d’homme faible qui convient parfaitement au jeu de Jean-Pierre Daroussin, mais avec une gravité, une façon corporelle de représenter la fatalité qui l’accable, nuançant et développant sa palette d’acteur. C’est sur des dettes que s’ouvre son récit, la toile de son drame, à laquelle s’ajoute la maladie de sa femme. Cette maladie, qui s’avérera fatale, est l’élément central des dialogues de la famille. L’aîné des deux fils, Ingemar, le plus froid, le plus désincarné, reproche à son père de n’être pas allé voir la malade assez souvent sur son lit d’hôpital. Il lui reproche aussi son alcoolisme, sa mauvaise gestion de l’établissement, la perte de pouvoir sur son autre fils. Un personnage qui contient une violence tacite et une haine explicite que le jeu distancié de Nicolas Pirson manque parfois d’incarner. L’autre fils, John, campé par Alban Guyon, est le double fictif de l’auteur. Un poète dont l’existence cherche à échapper aux dissonances familiales, en retrouvant la ville dont il revient tout juste. La verve de ce personnage, quelques fois agaçante par son arrogance, offre un contraste saisissant avec l’austérité de son frère, montrant par là toute la difficulté de vivre qu’éprouve cette figure romantique au sein d’une communauté en crise à laquelle il est inextricablement lié. Les deux femmes complètent le tableaux : la mère, la malade, qui se détache progressivement de la vie et de l’amour des siens, et Martha, la femme de ménage, spectatrice démunie de cette tragédie familiale.
Une atmosphère américaine
Comme souvent, pour le décor, Martinelli a choisi la ligne claire et le naturalisme. Sur la gauche, la froide réception de l’hôtel où se joue la vie de famille, avec ses hauts et ses bas, matérialisés par un grand escalier et une cabine d’ascenseur – qui ne servira jamais. A droite, une grande baie vitrée à travers laquelle le jour baigne les nappes immaculées des tables désertes. Par son réalisme épuré et ses jeux d’ombres et de lumières, la scénographie fait une référence appuyée aux peintures d’Edward Hopper, dont se dégage une certaine mélancolie. Cette atmosphère met en relief la dimension nostalgique de l’œuvre de Norén, tout en lui offrant cependant un cadre stylisé, qui déshumanise un peu les personnages. En outre, cette ambiance est accentuée par le jazz feutré qui domine la pièce, soit par l’alternance du piano et du saxophone que pratiquent respectivement les deux fils dans leur chambre, soit par une musique diffusée sur un vieux transistor – notamment lors d’un changement de décors spectaculaire où l’hôtel et son grand escalier se reculent pour laisser place à une mer floue et grise sur laquelle se découpe en néons bleus le nom de l’établissement : « Hotel Standard ». Cette mer, qui se dessinait déjà vaguement au fond de la scène, et qui bouche pour finir la perspective de l’espace, c’est l’horizon vers lequel se dirige chacun des personnages, c’est le fameux calme auquel ils aspirent. Une plénitude qu’ils n’atteindront qu’à travers la douleur, la révolution totale, le bouleversement qui se joue en ces quelques heures présentées. L’autre pendant de la pièce, l’aspect venimeux des relations au sein de la famille est, lui, signifié par le blues rageur de Janis Joplin sur lequel, dans un moment baroque et cathartique, John déclame un monologue rythmé aux allures de slam. Un instant de beauté un peu surfait qui met toutefois en lumière le talent d’Alban Guyon. Alors, pour la beauté du texte de Norén, le climat velouté que le metteur en scène a su en retirer et la maîtrise des comédiens qui pour certains se confirme – Jean-Pierre Daroussin – ou pour d’autres, se révèle – Alban Guyon, allez-y…
Par Romain Breton
Calme, au théâtre Nanterre-Amandiers, jusqu’au 23 février.













 [/popup]
[/popup]